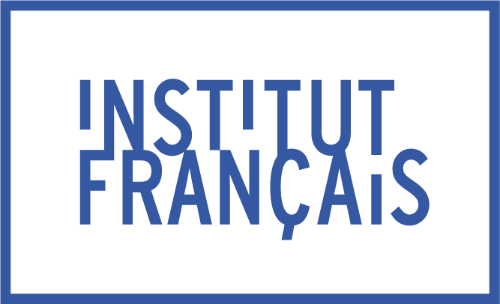Maria de Medeiros
Marraine de la 4ème édition du Pavillon Les Cinémas du Monde.
Comédienne, réalisatrice, mais aussi chanteuse, Maria de Medeiros poursuit depuis l’âge de 15 ans une brillante carrière internationale dans le théâtre et le cinéma. Fidèle à ses racines portugaises, française d’adoption et parfaite polyglotte, véritable « globe trotteuse du cinéma » comme elle aime à se qualifier parfois, Maria de Medeiros tisse, au fil de ses engagements personnels et artistiques, de multiples passerelles entre le Nord et le Sud, du Portugal aux Etats Unis, en passant par le Brésil ou encore le Mozambique. Membre du jury du festival de Cannes en 2007, Maria de Medeiros revient à Cannes cette année pour accompagner la délégation artistique du Pavillon Les Cinémas du Monde.
« Je suis sans doute une fille du rayonnement culturel de la France dans le monde. Bien avant d’habiter Paris et d’acquérir la nationalité française, j’ai été bercée par la langue de Ronsard, de Baudelaire ou de Rimbaud, autant que par celle de Pessoa. J’admirais l’impressionnisme, l’existentialisme, Léo Ferré, Georges Brassens, Jacques Prévert, Jacques Tati et François Truffaut. Toute ma scolarité s’est déroulée dans des lycées français à l’étranger, des établissements remplis d’enfants du monde entier, ayant en commun un certain esprit de la culture française. Et cet esprit dont je suis toujours éprise est celui de la curiosité, de l’attention à ce qui est divers et du soutien sans faille à la culture, à toutes les cultures du monde. C’est donc avec grande joie que j’accompagnerai les artistes présentant leurs projets cette année 2012 au Pavillon Les Cinémas du Monde. Paraguay, Chili, Brésil, Birmanie, Rwanda, Vietnam, Tunisie, Iran, Palestine, Madagascar, ce tour du monde cinématographique promet d’ores et déjà d’être riche en découvertes. Merci au Festival de Cannes de nous accueillir et de mettre à l’honneur les voix plurielles du cinéma. »

Elia Suleiman
Parrain de la 4ème édition du Pavillon Les Cinémas du Monde.
Révélé en 2002 avec Intervention divine (Prix du jury du Festival de Cannes) qui l’impose sur la scène internationale, le cinéaste palestinien Elia Suleiman construit depuis son premier long métrage, Chronique d’une disparition (Prix du meilleur premier film à la Mostra de Venise en 1996) une oeuvre singulière, tout à la fois poétique et profondément politique. Souvent comparé à Tati ou Buster Keaton, acteur dans ses propres films, il aborde de manière décalée les sujets les plus graves, notamment les conséquences du conflit israélo-palestinien, donnant à ses films une dimension universelle. Membre du jury du Festival de Cannes en 2006, en compétition officielle avec Le Temps qu’il reste en 2009, il accompagne cette année les artistes du Pavillon Les Cinémas du Monde.
« Lorsque je suis venu à Paris à la recherche d’un producteur pour mon premier long métrage, Chronique d’une disparition, j’errais du bureau d’un producteur à un autre, le plus souvent à pied. Pour m’y rendre plus vite, je ne m’aventurais pas dans le métro. Sous terre, je n’avais de cesse de me perdre ou de me tromper de direction. Et surtout, il me fallait une éternité pour trouver la « sortie », mot qui, à l’époque, pour moi, était dénué de signification. Les rares producteurs qui acceptaient de me recevoir afin de m’expliquer les raisons de leur rejet de mon scénario étaient de toute évidence de gauche. Les affiches de films accrochées à leurs murs ne laissaient aucun doute quant à leur solidarité avec la longue liste des causes justes à travers le monde. Je supposai donc que c’était ce même sentiment de solidarité qui les incitait à prendre le temps de me gratifier d’un conseil. Or il m’apparut que ce qui les animait était plutôt de l’ordre de la curiosité, ou de la perplexité, voire, dans un cas, de la contrariété. Ils cherchaient à savoir quelle espèce de Palestinien je pouvais être, si tant était que j’en fusse un. « Votre scénario n’est pas assez palestinien. ». « Je ne trouve absolument rien de palestinien dans votre scénario. Cette histoire peut se passer n’importe où dans le monde. ». « Vos personnages sont soit passifs, soit résignés.
Comment un peuple subissant une telle oppression pourrait ne montrer aucune résistance ? ». Voilà ce que me disaient leurs longs discours. « Mais si cela peut se passer n’importe où dans le monde, pourquoi pas en Palestine ? », m’interrogeais-je à mon tour. Un des producteurs me donna les coordonnées d’un réalisateur israélien de gauche : lui peut-être saurait me comprendre. Nous nous rencontrâmes dans un café à proximité de son appartement. Il se mit dans une colère noire contre moi, m’accusant d’être un suppôt des Américains. Il est vrai que j’habitais New-York à l’époque. Quelques années plus tard, je finis par produire moi-même mon film. Je me souviens d’une critique, élogieuse, qui prévenait en toute innocence : « C’est bien un film palestinien, mais ce n’est pas ce que vous croyez ! »
Bien des années et quelques films plus tard, on me présente de moins en moins comme « le cinéaste palestinien ». L’emphase n’est plus autant sur « palestinien » et l’on n’a plus à me classer comme plus ou moins palestinien. Je suis persuadé qu’un jour, le cinéma saura se détacher des identités nationales. Le cinéma ne reconnaît pas les frontières et nul ne saurait l’arrêter aux checkpoints, il apparaîtra donc clairement que la question identitaire n’est pas pertinente. Certes, des tentatives de maintenir artificiellement en vie la culture post-coloniale peuvent persister, mais en vain. Je me demande si c’est la résistance au colonialisme qui a eu raison de lui ou si ce sont les armées victorieuses du nouvel ordre mondial qui l’ont achevé. Peut-être sont-ce les deux. Quoi qu’il en soit, la révolution industrielle, vieille de quelque deux cents ans, qui contribua amplement à la dévalorisation du temps et la contraction de l’espace, a fini par se tirer une balle dans le pied. Notamment, en inventant la caméra qui fut utilisée comme arme de guerre, avant d’être retournée contre son créateur, provoquant ainsi involontairement l’essor du cinéma. Les frontières virtuelles entre l’Orient et l’Occident, entre le Nord et le Sud, s’effritent de longue date et tendent à présent à s’effondrer.
Le cinéma a la capacité de se regarder et de se mettre en lumière, se passant volontiers du miroir tendu par le désir de l’Autre. Nous avons récemment assisté aux événements liés aux Printemps, arabes ou non, qui ont fait trembler la terre et les fondations des pouvoirs en place, en faisant voler en éclats les miroirs reflétant leur décadence mondialisée et leur représentation déformée. La peur et l’anxiété, bien ancrées, se sont retournées contre ceux-là mêmes qui les avaient suscitées. Le marché financier virtuel a beau nourrir depuis toujours le rêve d’occuper le monde, le cinéma est là pour empêcher toute velléité d’occupation de l’âme. Par le regard intérieur, j’imagine, je désire, j’aime et je rêve. Ce que j’imagine est encore invisible pour autrui, mais porte en lui un possible visible, un possible partage. Dès l’instant de son apparition, je sais la transmission possible. En moi, des éclairs sporadiques éclatent et volent libres de toute gravité dans le cosmos. Le désordre apparent de ces particules lumineuses est entraîné par une attraction magnétique de chacune d’elles vers l’autre et vers leur totalité. Une promesse d’harmonie. J’attends. Mais le chaos persiste et m’angoisse. Je n’attends pas, je m’implique, je participe. Je me lance. Bien sûr, rien ne me rassure. Mais je trouve toujours quelque chose à quoi m’accrocher. Il y a toujours de l’espoir. Ainsi peut commencer le Cinématographe. »